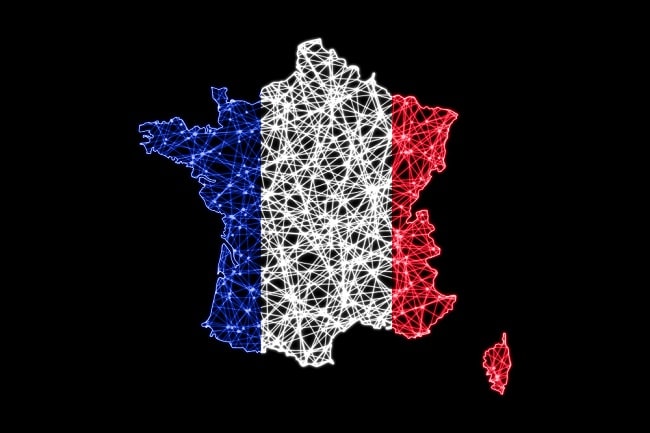En avril 2025, Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, affirmait que « la souveraineté numérique est une cause commune », orchestrant une grande soirée de mobilisation pour renforcer l’autonomie technologique française. Le gouvernement multiplie les annonces, lance des appels à projets ambitieux et promet de bâtir une Europe numérique indépendante.
Pourtant, derrière cette façade volontariste, la réalité révèle une tout autre histoire : celle d’un État qui prêche la souveraineté tout en consolidant sa dépendance aux géants américains du numérique.
Le scandale Microsoft : quand l’Éducation nationale fait le grand écart
L’Éducation nationale incarne à elle seule toute la schizophrénie française sur la souveraineté numérique. D’un côté, elle édicte des règles strictes imposant l’usage de solutions souveraines aux établissements scolaires. De l’autre, elle signe des contrats pharaoniques avec le géant américain Microsoft, exposant les données de millions d’élèves et d’enseignants aux législations extraterritoriales. Cette contradiction flagrante révèle une administration qui ne parvient pas à s’appliquer à elle-même les principes qu’elle impose aux autres.
Un contrat qui fait grincer des dents
En mars 2025, le ministère de l’Éducation nationale a attribué un marché public d’un montant minimum de 74 millions d’euros pour équiper ses services en solutions Microsoft, avec une enveloppe pouvant atteindre 152 millions d’euros sur quatre ans. Cette décision intervient paradoxalement quelques jours seulement après que le même ministère a enjoint les académies d’exclure « toute utilisation de solution non souveraine dans le domaine de l’éducation ».
Le député Philippe Latombe s’est insurgé contre ce contrat, soulignant que « sa doctrine technique du numérique pour l’éducation prône avec raison l’utilisation prioritaire de solutions libres et souveraines ». Plus troublant encore, cette nouvelle convention représente une nette hausse budgétaire par rapport au précédent contrat, alors même que les tensions transatlantiques et les enjeux de souveraineté n’ont jamais été aussi prégnants.
L’hypocrisie à tous les étages
L’incohérence atteint son paroxysme lorsqu’on constate que l’administration centrale s’affranchit des règles qu’elle impose aux autres. En septembre 2021, la DSI de l’État avait clairement indiqué que les solutions collaboratives, bureautiques et de messagerie « sont réputées relever de systèmes manipulant des données d’une sensibilité particulière ».
Le ministère demande aux académies de respecter scrupuleusement les principes de souveraineté numérique tout en signant lui-même des contrats massifs avec Microsoft. Cette situation révèle une administration à deux vitesses où les grands principes s’effacent devant les réalités pratiques et les habitudes bien ancrées.
Le CLOUD Act : l’épée de Damoclès ignorée
Alors que l’État français multiplie les contrats avec des entreprises américaines, une réalité juridique implacable plane au-dessus de toutes les données hébergées : le CLOUD Act. Cette législation américaine, adoptée en 2018, rend illusoire toute prétention à protéger les informations sensibles dès lors qu’elles sont confiées à des acteurs soumis au droit américain. Pourtant, malgré les alertes répétées des experts et les invalidations juridiques européennes, l’administration française continue d’ignorer délibérément cette menace existentielle pour sa souveraineté numérique.
Une menace réelle pour la souveraineté européenne
Le CLOUD Act américain, adopté en 2018, permet aux instances de justice américaines de contraindre les fournisseurs de services établis sur le territoire des États-Unis à fournir les données stockées sur des serveurs situés aux USA ou dans d’autres pays. Cette législation extraterritoriale représente une menace directe pour la souveraineté des données européennes.
Même si les serveurs sont physiquement localisés en France, un tribunal américain peut ordonner l’accès aux données. Cette réalité juridique rend illusoire toute prétention à une véritable souveraineté numérique tant que l’État français continue de dépendre massivement des solutions américaines.
L’échec du Privacy Shield et ses conséquences
La Cour de justice de l’Union européenne a invalidé en juillet 2020 l’accord de « libre circulation » des données connu sous le nom de « Privacy Shield » car il ne pouvait garantir un niveau de protection des données conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette décision historique confirme l’incompatibilité fondamentale entre les exigences européennes de protection des données et la législation américaine de surveillance.
Malgré cette invalidation, les administrations françaises continuent de s’appuyer massivement sur des solutions américaines, créant une situation juridiquement précaire où les données sensibles de millions de citoyens restent potentiellement accessibles aux autorités américaines.
Les alternatives souveraines existent mais restent ignorées
Le plus frustrant dans cette situation est que la France n’est pas démunie face aux géants américains. Un écosystème technologique français et européen performant existe, certifié et prêt à répondre aux besoins de l’administration. Des entreprises innovantes proposent des solutions respectant pleinement les exigences de souveraineté et de sécurité. Mais ces champions nationaux se heurtent à un mur d’indifférence institutionnelle, voyant les marchés publics leur échapper au profit de leurs concurrents américains, même lorsqu’ils proposent des solutions techniquement supérieures.
OVHcloud et l’écosystème français
La France dispose pourtant d’acteurs technologiques capables de proposer des alternatives crédibles. OVHcloud a obtenu la qualification SecNumCloud pour son service de cloud privé, garantissant qu’aucune donnée ne sera accessible, transférée ou traitée en dehors de l’Union européenne. Cette certification, délivrée par l’ANSSI, atteste du respect des plus hauts standards de sécurité et de souveraineté.
D’autres acteurs français comme Cloud Temple, Clever Cloud ou Oodrive proposent également des solutions qualifiées SecNumCloud, offrant une véritable immunité face aux législations extraterritoriales. Ces entreprises démontrent qu’une alternative souveraine est non seulement possible mais déjà opérationnelle.
Le paradoxe de l’investissement public
Le président de la République a annoncé en juin 2023 un plan de 2,2 milliards d’euros pour l’IA, dont 1,5 milliard d’euros de financements publics. Parallèlement, l’État lance des programmes ambitieux comme France 2030, doté de 54 milliards d’euros, pour développer les technologies d’avenir et la souveraineté numérique.
Ces investissements massifs dans l’innovation française contrastent cruellement avec les choix opérationnels de l’administration qui continue de privilégier les solutions américaines. Comment justifier de tels financements pour développer une filière souveraine si l’État lui-même ne devient pas le premier client de ces solutions ?
Le scandale Visibrain : la veille souveraine sacrifiée sur l’autel du prix
Si le cas de l’Éducation nationale illustre l’hypocrisie structurelle, l’affaire Visibrain de juin 2025 révèle une dimension encore plus cynique : celle d’un État prêt à compromettre sa capacité de veille stratégique et de lutte contre la désinformation pour économiser quelques euros. Dans un domaine aussi sensible que l’analyse de l’opinion publique et la détection des manipulations informationnelles, le gouvernement français a choisi de confier ses données à des intérêts américains, abandonnant au passage un champion national reconnu pour son excellence technique.
Un champion français évincé au profit d’intérêts américains
En juin 2025, en plein VivaTech où la souveraineté numérique était sur toutes les lèvres, un scandale révélateur éclate : Visibrain, seul acteur français indépendant spécialisé dans la veille stratégique des réseaux sociaux, est évincé d’un appel d’offres du Service d’Information du Gouvernement (SIG) qu’il détenait depuis 2017.
Le paradoxe est saisissant : Visibrain obtient la meilleure note technique parmi tous les candidats mais perd le marché au profit de Talkwalker, une solution luxembourgeoise rachetée en 2024 par le canadien Hootsuite, lui-même contrôlé par des capitaux américains. La raison ? Une offre commerciale jugée trois fois inférieure, privilégiant ainsi le prix à la souveraineté pour un outil stratégique de veille informationnelle où transitent des données sensibles sur l’opinion publique française.
L’indignation parlementaire
La sénatrice Vanina Paoli-Gagin s’insurge lors d’une question au gouvernement le 25 juin 2025 : « On ne peut pas à la fois appeler à une plus grande souveraineté numérique et opter pour de l’achat public non européen dès que l’occasion se présente ». Elle rappelle que Visibrain représente une expertise unique en France dans l’analyse des réseaux sociaux et la détection de tendances, un domaine critique pour l’anticipation des crises et la lutte contre la désinformation.
La parlementaire dénonce le caractère « irresponsable » de cette décision qui livre aux puissances étrangères l’accès à des informations stratégiques essentielles pour les services de renseignement et de sécurité nationale. Cette mine de données sur l’opinion publique française, les mouvements sociaux et les tentatives de manipulation devrait rester sous contrôle souverain, particulièrement dans le contexte géopolitique tendu que nous traversons.
Les révélations parlementaires : un constat accablant
Face à ces scandales à répétition, le Parlement français s’est saisi du sujet à travers plusieurs commissions d’enquête en 2025. Leurs conclusions sont sans appel : l’État français est structurellement incapable de garantir sa souveraineté numérique. Entre désorganisation administrative, méconnaissance des enjeux et absence de vision stratégique, les parlementaires dressent le portrait d’une administration qui navigue à vue dans un domaine pourtant crucial pour l’indépendance nationale.
Les commissions d’enquête tirent la sonnette d’alarme
Les travaux parlementaires de 2025 multiplient les alertes sur la souveraineté numérique. La Commission d’enquête sur la commande publique, après avoir auditionné 85 témoins, pointe du doigt l’incapacité structurelle de l’État à intégrer les enjeux de souveraineté dans ses achats publics de solutions numériques. Les sénateurs dénoncent une administration désorganisée où les différentes directions agissent sans coordination, permettant ainsi aux habitudes et aux dépendances technologiques de perdurer.
Les sénateurs ont également mis en lumière l’incapacité de l’État à mesurer et évaluer correctement les enjeux de souveraineté dans ses achats publics. La Commission d’enquête sénatoriale sur la commande publique s’est focalisée sur la question inquiétante d’un achat public de solutions numériques peu sensible aux questions de souveraineté.
Un manque de cohérence stratégique
Les travaux parlementaires révèlent une administration désorganisée, où les différentes directions et agences de l’État agissent sans coordination réelle sur les questions de souveraineté numérique. Cette fragmentation empêche l’émergence d’une véritable stratégie nationale cohérente et permet aux habitudes et aux facilités de perdurer.
L’Europe : entre ambitions et contradictions
La France n’est pas seule dans ses contradictions. L’Union européenne elle-même oscille entre des ambitions réglementaires fortes et une impuissance pratique face à la domination américaine. Malgré des initiatives ambitieuses et un arsenal juridique croissant, l’Europe peine à traduire ses principes en réalité opérationnelle. Les projets se multiplient, les certifications s’accumulent, mais les géants américains continuent de régner en maîtres sur le marché européen du cloud et des services numériques.
Les initiatives européennes
L’Union européenne se positionne comme une puissance normative, soutenant le renforcement des institutions démocratiques et proposant un socle nouveau de réglementations afin de mieux responsabiliser les acteurs du numérique. Des projets comme GAIA-X visent à créer une infrastructure de données européenne souveraine.
Cependant, ces initiatives peinent à se concrétiser face à la domination écrasante des acteurs américains. Selon Siècle Digital, les hyperscalers américains détiennent 72% du marché du cloud européen, illustrant l’ampleur du défi à relever.
Le label « Cloud de confiance » : une réponse insuffisante
Le gouvernement français a annoncé en mai 2021 la mise en œuvre d’un nouveau label « cloud de confiance » s’appuyant sur la qualification SecNumCloud. Cette initiative, bien que louable, reste largement ignorée dans les faits par les administrations elles-mêmes, comme le démontre le récent contrat Microsoft de l’Éducation nationale.
Les conséquences concrètes de cette hypocrisie
Au-delà des contradictions politiques et des scandales médiatiques, cette hypocrisie institutionnelle produit des effets dévastateurs sur l’écosystème numérique français. Les dommages se mesurent en entreprises fragilisées, en innovations abandonnées et en vulnérabilités stratégiques croissantes. Chaque décision incohérente de l’État envoie des ondes de choc qui affaiblissent durablement la capacité de la France à construire son autonomie technologique. Les conséquences de cette schizophrénie administrative dépassent largement le cadre des marchés publics pour menacer l’ensemble de la filière numérique nationale.
Un message contradictoire aux entreprises
Comment l’État peut-il exiger des entreprises françaises qu’elles adoptent des solutions souveraines alors qu’il ne montre pas l’exemple ? Cette incohérence envoie un signal désastreux au marché et décourage les investissements dans les solutions françaises et européennes.
La fragilisation de la filière française
Les associations d’entreprises du numérique dénoncent le fait que cette convention « met d’abord fin à plusieurs années de soutien du gouvernement à la filière française du secteur ». Les acteurs français du cloud et du logiciel libre voient leurs efforts sapés par les choix contradictoires de leur propre administration.
Les risques pour les données sensibles
Au-delà des questions économiques, cette dépendance pose des risques réels pour la sécurité des données sensibles. Les données de santé, d’éducation, de défense restent potentiellement accessibles aux autorités américaines, créant des vulnérabilités stratégiques majeures pour la France.
Vers une véritable souveraineté : les conditions du changement
Face à ce constat d’échec, la question n’est plus de savoir si la France doit changer de cap, mais comment opérer cette transformation radicale. Les solutions existent, les acteurs sont prêts, les technologies sont disponibles. Ce qui manque cruellement, c’est une volonté politique ferme doublée d’une stratégie cohérente et d’une exécution rigoureuse. Pour sortir de cette spirale de dépendance, la France doit engager une rupture profonde avec ses pratiques actuelles et accepter que la souveraineté numérique a un prix : celui du courage politique et de l’investissement de long terme.
Aligner les actes sur les discours
La première étape consiste à mettre fin à cette schizophrénie institutionnelle. Si la souveraineté numérique est vraiment « une cause commune », l’État doit devenir exemplaire dans ses choix technologiques. Cela implique de privilégier systématiquement les solutions européennes certifiées SecNumCloud pour tous les marchés publics sensibles.
Investir massivement dans l’écosystème souverain
Les milliards annoncés pour la souveraineté numérique doivent se traduire par des commandes publiques concrètes. L’État doit devenir le premier client des solutions souveraines qu’il prétend promouvoir, créant ainsi un cercle vertueux de développement et d’innovation.
Renforcer le cadre juridique
La France et l’Europe doivent aller au-delà des certifications et créer un véritable bouclier juridique contre l’extraterritorialité des lois américaines. Cela peut passer par des sanctions pour les administrations qui ne respectent pas les principes de souveraineté ou par l’interdiction pure et simple de certaines solutions pour les données les plus sensibles.
Former et sensibiliser les décideurs
L’ignorance ou l’incompréhension des enjeux de souveraineté numérique par de nombreux décideurs publics explique en partie ces choix contradictoires. Un effort massif de formation et de sensibilisation est nécessaire pour que chaque responsable d’achat public comprenne les implications de ses décisions.
L’urgence d’une cohérence retrouvée
La souveraineté numérique ne peut rester un simple élément de langage politique. Face aux menaces réelles que représentent les législations extraterritoriales et la domination des géants américains du numérique, la France doit urgemment aligner ses actes sur ses ambitions.
Comme l’affirmait la ministre Clara Chappaz, « Il n’y a pas de prospérité économique durable sans souveraineté numérique ». Cette vérité s’applique d’abord à l’État lui-même. Tant que l’administration française continuera de signer des contrats massifs avec des entreprises américaines tout en prêchant la souveraineté, elle sapera ses propres efforts et ceux de tout un écosystème.
Le temps des discours est révolu. L’heure est venue pour la France de choisir : soit elle assume pleinement sa dépendance technologique et abandonne ses prétentions souverainistes, soit elle engage une véritable rupture avec les pratiques actuelles. Dans un monde où les données sont devenues le nouveau pétrole et où la technologie détermine les rapports de force géopolitiques, ce choix déterminera la place de la France dans le concert des nations pour les décennies à venir.
Lire plus d’articles sur DigiTechnologie :
– La révolution du travail hybride, cliquez-ici
– Le monde du travail bousculé par l’IA, cliquez-ici
– Trouver une formation digitale à Rennes, cliquez-ici
– L’intelligence artificielle et la réglementation, cliquez-ici